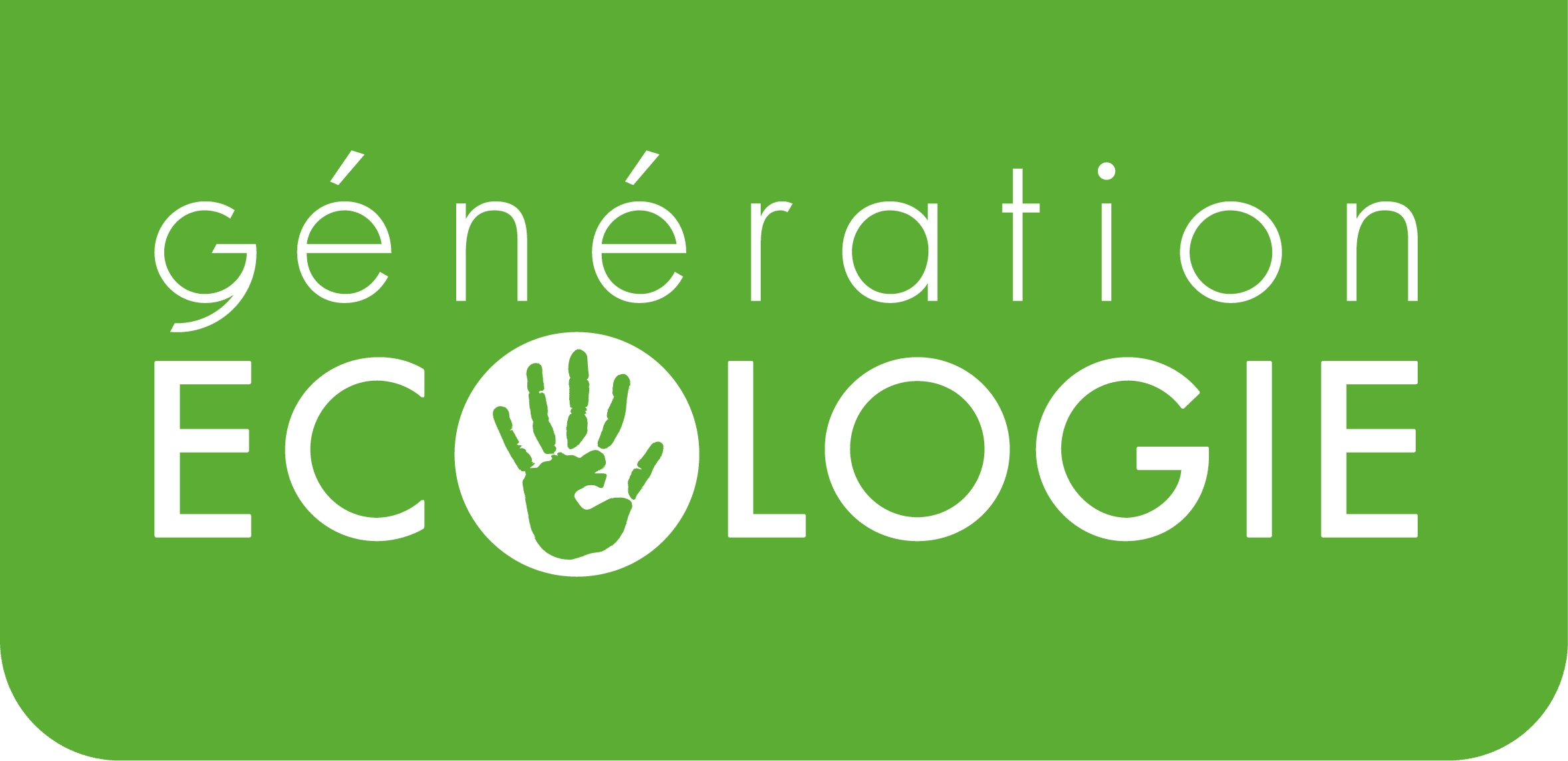08 septembre 2025
Entretien avec Cécile Cholley, référente de Génération Écologie dans l’Aude, sur le traumatisme vécu par la population et par ce territoire frappé par de violents incendies en août, dont celui de Ribaute qui a ravagé 16000 hectares en seulement deux jours.

Tu as vécu de près les violents incendies de cet été dans le département de l’Aude, peux-tu nous raconter comment ce drame a été vécu par les habitantes et les habitants du département ?
L’Aude a connu plusieurs incendies cet été mais celui dont nous parlons aujourd’hui, qui a dévasté les Corbières, a marqué les esprits par son intensité et par sa durée. Le feu de Ribaute a été vécu comme un cataclysme. On avait déjà eu deux incendies importants et celui-ci a vraiment été terrible parce qu’il est allé très très vite. Sa vitesse de propagation était de 5 à 6 km/h, poussé par une forte tramontane. Les flammes s’élevaient à environ 15 mètres dans un endroit des Corbières peu accessible. Ce feu a été ravageur pour les habitantes et les habitants mais aussi pour la nature. L’accès à la zone étant difficile, voire interdit, de nombreuses habitantes et habitants n’ont pas pu regagner leur domicile avant le 8 août. D’autres sont restés au contraire coincés dans leur domicile. Une dame est d’ailleurs décédée chez elle.
Nous avons vécu une panique incroyable, une sidération car nous n’avons pas compris immédiatement l’ampleur de ce qui se passait. Il y a eu un grand élan de solidarité, une formidable mobilisation dans tout le département, notamment pour loger les gens qui ne pouvaient plus rentrer chez eux, pour apporter de la nourriture et de l’eau aux pompiers qui n’avaient pas de ressources, ce qui est hallucinant.
Sur le terrain, nous avons vécu cela comme une forme d’apocalypse. Certaines personnes se sont retrouvées confinées chez elles avec les Canadairs faisant des allers-retours au-dessus de leurs têtes toute la journée, dans une angoisse palpable. Ils n’avaient pas le droit de sortir, pas le droit d’aller travailler pour faciliter l’accès des pompiers. Je pense surtout aux personnes qui vivent seules et qui sont restées chez elles, sans avoir accès à aucune information, ni moyen de communication. Tout était coupé, les antennes téléphoniques… Certaines personnes sont restés 24 heures sans aucun contact alors qu’elles vivaient une situation terrifiante. Aujourd’hui les habitants sont traumatisés par ce dernier incendie, les autres ont été difficiles bien sûr, mais celui-ci, par son intensité, sa vitesse, sa violence a laissé des traces encore vives.
Une personne est décédée, il y a eu 24 blessés. Et cela va prendre du temps pour se remettre de cet épisode-là. Il y a des gens qui ont tout perdu : leur maison, leur exploitation agricole, leur forêt. La faune sauvage paie un lourd tribut elle aussi, beaucoup d’animaux n’ayant pu fuir.
La population est encore en état de choc, en stress post-traumatique.
Peux-tu nous expliquer comment s’est organisée la lutte contre l’incendie, quelles forces vives mobilisées ? D’après toi, les moyens étaient-ils à la hauteur de l’enjeu ?
Je pense que cet épisode est révélateur d’une grande impréparation, même si personne n’attendait un incendie aussi violent. Les moyens mis en place étaient importants, on est monté jusqu’à 2000 pompiers sur place qui sont venus aussi d’autres régions, notamment de Franche-Comté. Je pense que tous les moyens disponibles ont été déployés. Neuf Canadairs et toutes les forces de lutte aérienne anti feux étaient en action contre cet incendie que personne n’arrivait à maîtriser. Donc des moyens il y en a eu. Après voilà, cela n’a pas suffi face à l’ampleur, la vitesse de propagation et face à la difficulté d’accès aux sites touchés. Si un autre incendie d’ampleur s’était déclaré ce jour-là en France, ça aurait été une catastrophe. On le sait, la flotte aérienne de lutte contre les feux est insuffisante et vétuste. Sans compter que les Canadairs depuis leur base de départ à Nîmes mettent environ 2h30 à arriver ici. Entre le moment où le feu se déclenche et où les Canadairs arrivent, le feu est déjà hors de contrôle.
Cela pose la question du maillage territorial de ces forces aériennes. Un autre problème face à l’ampleur du phénomène c’est que nous n’avons pas la culture du risque, nous ne sommes pas prêts à affronter des mégafeux.
Depuis que le feu est éteint, quel est la situation ? Qu’aurait-il pu être fait pour empêcher ce drame ou en limiter les impacts ?
Notre territoire est viticole, rural, composé majoritairement de garrigues. Une très forte sécheresse, des problèmes d’eau, une vague de chaleur terrible, des vents violents : tous les ingrédients sont réunis pour un embrasement rapide. On ressent une forme de négligence globale.
Il y a beaucoup à faire pour l’entretien de tous ces territoires de garrigues. Et alors que les vignes sont de véritables remparts aux flammes, l’arrachage des vignes se poursuit car le monde viticole va mal. Le résultat de l’absence de débroussaillage ou presque, c’est que la garrigue, très inflammable, a repris ses droits. Je pense que les obligations de débroussaillage ne sont pas respectées et ne sont pas sanctionnées.
Un des seuls villages qui a été épargné dans le secteur (16 communes ont été touchées), c’est celui dans lequel il y avait encore un berger avec des chèvres. Ce sont les chèvres qui ont débroussaillé, ce qui a beaucoup aidé à ralentir l’avancée des flammes. Cela a permis d’éviter que le feu ne se propage sur cette commune. C’est la preuve qu’il faut remettre de la vie dans ce territoire qui est parfois laissé à l’abandon. En Provence, on contrôle et on sanctionne quand ce n’est pas débroussaillé, mais cette action préventive est rarement faite ici. Il faut remettre du pastoralisme, de la vie et de la paysannerie.
Il y a aujourd’hui plus que jamais un vrai besoin de prévention globale des risques. Il faut savoir que l’Aude est le deuxième département le plus pauvre de la métropole. Il n’est pas exclu que le département ne dispose pas de moyens suffisants pour les SDIS et autres services d’urgence. On a aujourd’hui plus de points d’interrogation que de réponses, mais il va falloir étudier cela pour éviter ce type de catastrophes à l’avenir. Car il est certain qu’avec le changement climatique, les sécheresses et épisodes caniculaires vont devenir de plus en plus intenses.
Pour finir, même si l’incendie de Ribaute n’a pas démarré sur une autoroute, j’ai pu constater de mes yeux une négligence de la part de Vinci, le concessionnaire des autoroutes. J’ai pu voir fin juillet des tapis épais d’aiguilles de pin, tout le long des bandes d’arrêt d’urgence entre Narbonne et Port-la-Nouvelle. Le manque d’entretien en période estivale aggrave le risque de départ de feux.
Récemment la zone sinistrée a aussi beaucoup fait parler à cause d’une rave partie qui s’est tenue sur les cendres des territoires dévastés. Comment ça a été vécu sur le territoire ?
Évidemment, ce n’était ni le moment ni l’endroit de faire une rave party. Je ne suis pas contre l’idée de faire la fête, mais c’était particulièrement inconvenant de faire cela à cet endroit là à ce moment-là. Les festivités ont débuté le 29 août alors que les feux ont été déclarés éteints le 28 août. Il n’y a donc eu aucun temps de latence, je pense même que c’était préparé parce que du jour au lendemain, 2 500 participants sont arrivés, organisés, avec de nombreux véhicules dans une zone pourtant interdite à la circulation par la Préfecture – et qui l’est toujours d’ailleurs.
Les habitantes et habitants sur place étaient déjà traumatisés et cette rave party a été un coup de grâce. Cela a remué le couteau dans la plaie. L’incompréhension des populations a laissé place à des actes de violence. La préfecture a apparemment tardé à réagir. Des vignerons excédés sont allés en découdre avec les teufeurs. L’intervention policière est venue plus tard, laissant la population désespérée se débrouiller.
Sur le terrain où s’est tenue la rave party, des agriculteurs essayaient de faire pousser de la luzerne, mais aujourd’hui en plus des cendres, le sol est compacté et des détritus ont été abandonnés par les fêtards.
Certaines personnes étaient dans un état second, peut-être sous l’effet de drogues et ne comprenaient même pas le mal qu’ils faisaient. C’est de l’inconscience. Danser sur les cendres, voire même sur les tombes de ceux qui ont tout perdu, c’était la dernière chose à faire.
Selon toi, quels enseignements la France doit-elle tirer de cette catastrophe et quelle serait une politique de prévention des feux pour la France ?
La question des risques n’est pas un sujet sexy en période électorale. Les politiques ont du mal à s’en emparer, parce que ça ne fait pas rêver. Mais aujourd’hui il faut regarder la réalité en face. Cette année, on l’a vécu ici, mais demain, on le vivra dans d’autres départements. Je pense d’ailleurs à Marseille qui a aussi vécu de violents incendies cet été.
C’est une question de survie de nos territoires, il faut que les autorités s’en emparent et mettent en place des plans de prévention sérieux. Cela inclut les questions d’aménagement du territoire, surtout que le risque incendie n’est pas le seul : les inondations sont un autre vrai sujet. La violence des épisodes méditerranéens est aussi un sujet de préoccupation.
De nombreux phénomènes météorologiques menacent nos régions. Ne pas les prendre en compte, faire l’autruche, cela conduit à des situations cataclysmiques comme cet été dans l’Aude. Si on ne fait rien, cela se reproduira. On a parlé des Canadairs, il faut repenser le territoire, repenser le pastoralisme et l’agriculture paysanne, encourager l’installation d’une agriculture respectueuse des terres, de la faune et de la flore. Ce que les grandes exploitations qui bossent avec l’agroalimentaire ne font pas.
L’été prochain des feux se répéteront et si on ne fait rien, ce seront les mêmes catastrophes et on ne pourra plus dire qu’on est surpris. Un défaut de préparation deviendra une faute inexcusable.
Pour terminer sur une note positive, je voudrais quand même donner de l’espoir : les terres brûlées ne sont pas mortes. La vie reprendra ses droits. Ça prendra peut-être 20 ans mais la nature est ainsi faite qu’après un incendie, la vie revient. C’est pourquoi il faut les protéger pour que la vie reprenne dans de bonnes conditions. On est contraints d’interdire l’accès à certains massifs en été, à cause de l’inconscience de certains. Mais on ne peut pas être dans le défaitisme, nous n’avons plus les moyens d’être dans le défaitisme. Aujourd’hui, il faut être dans l’action et la responsabilité.
Cécile CHOLLEY, référente Génération Écologie de l’Aude
Pour en savoir plus sur nos propositions en matière de sécurité civile, retrouvez le discours de Delphine Batho en 2022 face à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France : https://generationecologie.fr/2022/03/11/pour-un-ministere-regalien-resilience-protection-civile-urgence/