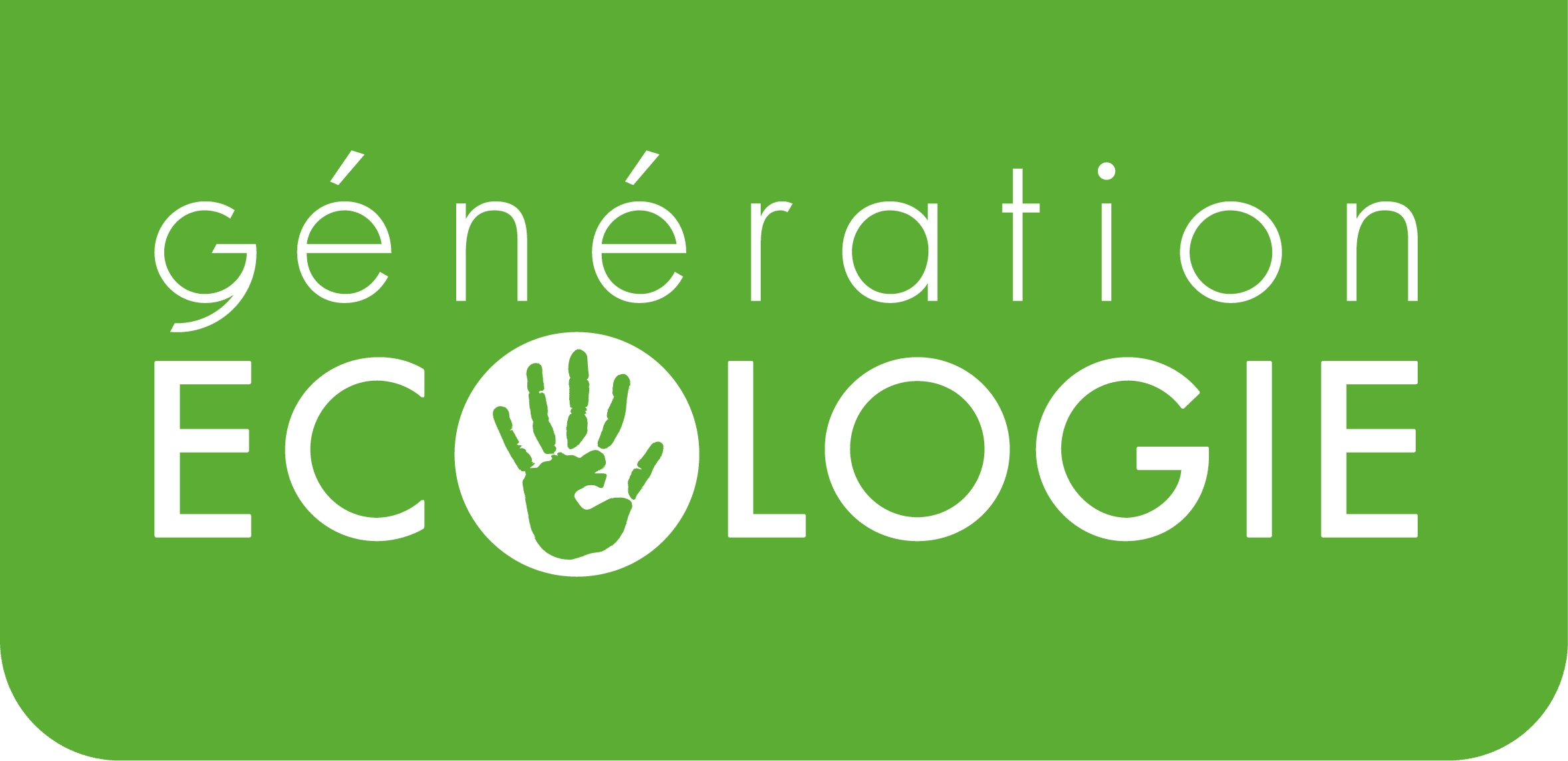28 octobre 2024
Suicide, burn-out, dépression sont-ils les conséquences du modèle de société basé sur l’obsession de la croissance dans lequel nous vivons ? La question n’est pas nouvelle. Dès 1897, Emile Durkheim, père de la sociologie française, tentait d’expliquer le suicide par la qualité de l’intégration, de la régulation et des liens sociaux (Le suicide, 1897). Depuis, la psychiatrie moderne a consacré la suprématie des approches biologiques et médicales sur les approches sociales et comportementales. De fait, nul ne conteste les progrès acquis grâce aux médicaments. Mais dans une société en perte de repères, où l’augmentation de la solitude, la perte des liens et les injonctions contradictoires sont légion, n’est-il pas légitime de questionner l’impact de notre modèle de société sur le mal-être général ?
Dans le rapport L’économie du burnout : pauvreté et santé mentale récemment publié, Olivier de Schutter, Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, pose sur cette question un regard audacieux. Il estime qu’un nombre significatif d’études permettent de considérer que les pathologies psychiatriques sont largement explicables par l’augmentation des inégalités que génère notre société orientée sur la quête sans fin de croissance économique. Il a identifié dans la littérature scientifique des données qui établissent des liens entre la santé mentale, les craintes de déclassement, la compétition pour le statut social et la pauvreté.
Aujourd’hui 11 % de la population mondiale souffre d’un problème de santé mentale : la dépression touche plus de 200 millions de personnes, 301 millions de personnes sont sujettes à des troubles d’anxiété et chaque année 700 000 personnes se suicident. La prévalence de la dépression et de l’anxiété a augmenté de 25 % l’année suivant de la pandémie de COVID-19, une augmentation communément expliquée par un isolement accru et une précarité exacerbée. La France demeure quant à elle un des plus gros consommateurs de médicaments psychotropes. En 2021, la hausse de la consommation chez les mineurs y a été de 224% pour les hypnotiques, 23% pour les antidépresseurs, 16% pour les anxiolytiques et 7,5% pour les antipsychotiques.
Cela posé, il n’existe pas, en France, de données longitudinales permettant de corréler avec certitude le nombre de troubles mentaux à la détérioration des conditions de travail ou aux crises économiques. Une étude statistique de l’Insee datant de 2016 estime certes que « la grande majorité des études existantes met en évidence un effet persistant du chômage sur une variété d’indicateurs de santé mentale, […] notamment sur les troubles anxieux et la prise de médicaments« . Mais les données paraissent insuffisantes pour établir une causalité directe entre le système économique et les troubles mentaux. Difficile dans ces conditions d’avoir des certitudes.
Et pourtant, des voix s’élèvent pour affirmer que nous ne voyons pas le problème parce qu’il est mal posé. Plutôt que de considérer la détresse mentale comme une réaction compréhensible à des problèmes sociétaux plus larges, nos sociétés auraient privilégié une vision médicale du problème, le situant uniquement au niveau du cerveau de la personne qui en souffre, c’est-à-dire de son fonctionnement biologique ou de sa « capacité » à surmonter les chocs et les épreuves. Or cette approche médicaliste arrange tout le monde, en premier lieu les grandes entreprises du médicament, mais aussi les vendeurs de développement personnel, qui surfent sur l’illusion que l’amélioration de soi préserverait du malheur (Thierry Jobart, Contre le développement personnel, 2021).
Dans un ouvrage de 2021 (non traduit, Sedated : How Modern Capitalism Created our Mental Health Crisis) le Dr Davies affirme par exemple que beaucoup de ceux qui se voient prescrire des médicaments psychiatriques « ne souffrent pas de problèmes biologiquement identifiables » mais plutôt des conséquences douloureuses des difficultés de la vie – ruptures familiales, problèmes au travail, drames personnels, faible estime de soi, etc, lesquelles sont directement imputables à l’environnement socio-économique. Iain Ferguson avant lui posait la question de la relation entre capitalisme et maladie mentale (Politics of the Mind : Marxism and Mental Distres, 2017).
Olivier de Schutter appartient à cette école : “Imputée à un dysfonctionnement de neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la dopamine, la pandémie de santé mentale est en réalité plutôt due à d’intenses pressions en faveur d’une productivité accrue et à une volonté de posséder toujours plus”. Il fait reposer son raisonnement sur des études internationales conduites simultanément dans des dizaines de pays sur des échantillons pouvant aller jusqu’à 250 000 personnes.
Il avance aussi que la vulnérabilité à la souffrance mentale serait moins liée à la richesse en valeur absolue qu’à la position relative de l’individu dans sa communauté. La perte de statut ou la crainte du déclassement seraient des facteurs de risque particulièrement importants, expliquant ainsi des pathologies des cadres supérieurs apparemment préservés économiquement. Déjà en 1995, Philippe Thureau Dangin décrivait cette mécanique mortifère de la compétition permanente conduisant les cadres des grandes entreprises à la dépression (La concurrence et la mort, 1995).
Enfin, Olivier de Schutter pose la question du sens. “En réalité, le mal-être constaté [tiendrait] plutôt au sentiment des personnes concernées que leur contribution à la société n’était pas suffisamment valorisée”. Or on ne compte plus les sondages qui montrent que les jeunes sont de plus en plus nombreux à ne plus vouloir jouer le jeu du système (les bifurqueurs) ou à vouloir jouer un jeu « moins absurde » (52% des jeunes actifs seraient prêts à changer pour un emploi plus plaisant mais moins rémunéré, une proportion largement supérieure à celle (34%) observée dans l’ensemble de la population active. Ifop, octobre 2024). Dès lors, comment ne pas faire le lien avec les thèses d’un Tim Jackson, pour lequel “en cédant tout à un processus accéléré de consommation et de gaspillage, […] nous dévalorisons le but même et le sens du travail” (Post croissance, vivre après le capitalisme, Actes Sud 2024) ou d’un Gaspard Koening, expliquant récemment dans une interview au Figaro que “Si l’on passe son temps à appliquer des process sans savoir où ils mènent et sans disposer de marge de manœuvre, le travail devient terriblement aliénant”.
L’apparition du burn-out dit quelque chose de cette difficulté que nous avons à faire le lien entre maladie mentale et modèle de société. Décrit outre-Atlantique dès les années 70, le terme est popularisé en France en 2008 suite à la vague de suicides chez France Télecom. Il faudra pourtant attendre dix ans pour qu’il entre dans le débat public en 2017 puis 2018, d’abord par Benoit Hamon pendant la campagne présidentielle puis par François Ruffin dans une proposition de loi. Sujet « interdit », voire tabou pour les directions d’entreprises, le burn-out concernerait pourtant 400 000 personnes chaque année. L’éco-anxiété, qui ne doit pas être considérée comme une pathologie, toucherait déjà 8 français sur 10, (rapport annuel du Conseil économique social et environnemental sur l’état de la France, d’octobre 2023). Combien d’éco-anxieux risquent de sombrer dans la dépression ou des troubles plus graves à mesure que les catastrophes s’accumulent et les touchent directement ?
Ceux qui affirment que les maladies mentales sont en partie causées par le dogme de la croissance sont encore très minoritaires. Nous sommes en revanche beaucoup plus nombreux à avoir l’intuition que dans un monde où compétition et consommation ostentatoire tiennent lieu de boussole, où les injonctions contradictoires sont quotidiennes, le mal-être pourrait encore progresser. Dans ce contexte, le rapport d’Olivier Schutter a l’immense mérite de poser les bases d’une approche nouvelle de la maladie mentale, s’intéressant à ses causes. À l’heure où les souffrances psychiques explosent et où le Premier ministre Michel Barnier annonce vouloir faire de la santé mentale une grande cause nationale, n’est-il pas temps de se pencher sérieusement les méfaits de la croissance ?
Claire DAGNOGO