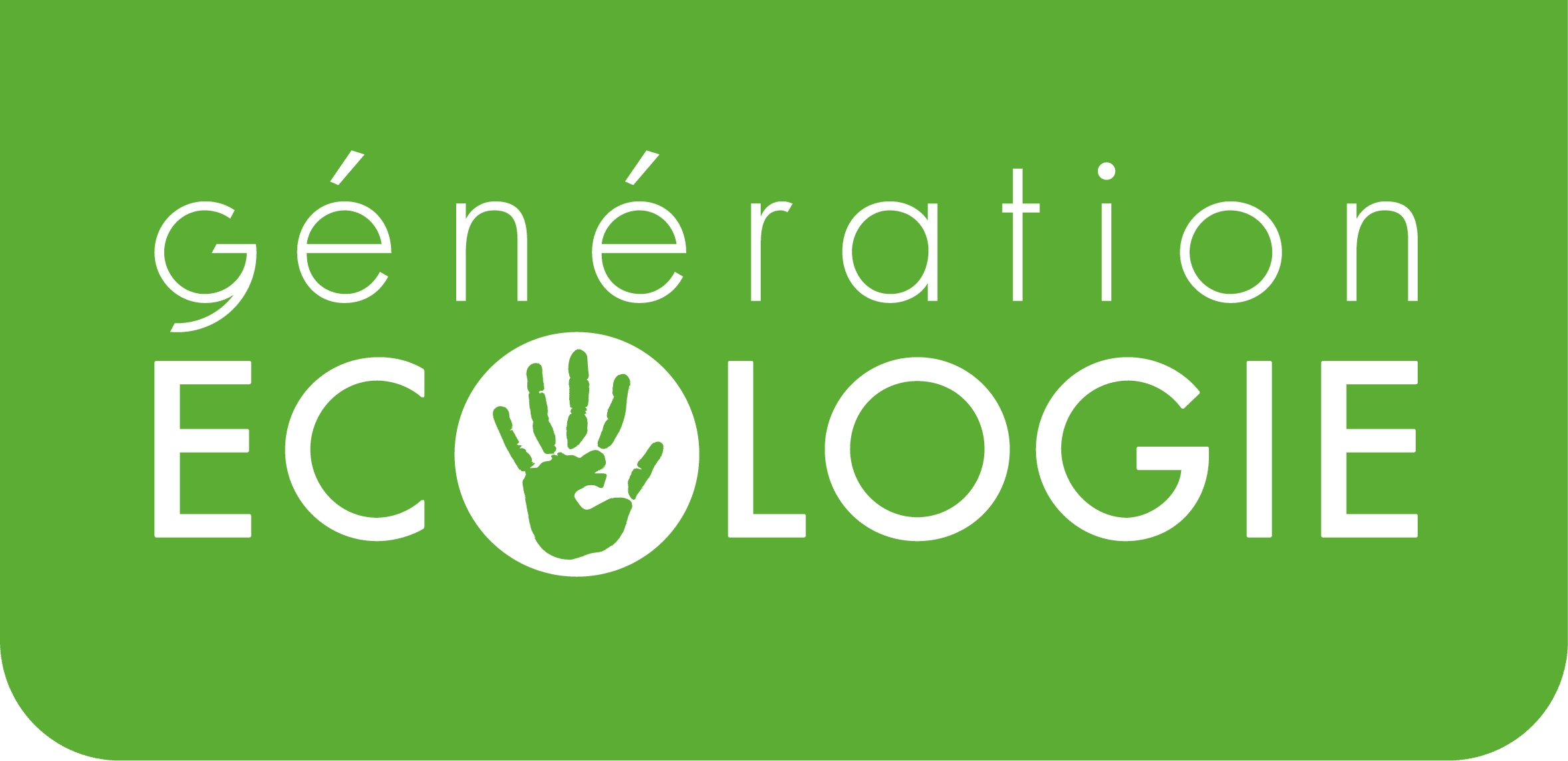21 mars 2025
Nous partageons la retranscription de l’intervention orale de Fanny VERRAX lors de la soirée d’échanges sur la situation géopolitique, la défense et l’écologie organisée par Génération Écologie le 13 mars 2025, qui clarifie des notions essentielles sur les terres rares et les métaux dans le contexte géopolitique actuel.
Vocabulaire
Souvent, les médias font beaucoup de confusions entre les métaux rares, les métaux stratégiques, les métaux critiques, les terres rares… Tout cela ne veut pas tout à fait dire la même chose.
Quand on parle de métaux rares, on parle d’une rareté géologique.
Les terres rares ne sont pas du tout des métaux rares. Les terres rares, sont une famille de 17 métaux, qui comprend les lanthanides et le scandium et l’yttrium, qui ne sont pas particulièrement rares dans la croûte terrestre. Par exemple, si on prend la terre rare la plus fréquente, c’est le cérium qui est plus abondant que le cuivre ou l’argent. Donc les terres rares ne sont pas géologiquement rares. Ce sont des métaux critiques très inégalement répartis.
On parle aussi de métaux stratégiques. Ça, c’est un terme plutôt économique, pour dire qu’ils sont stratégiques pour un secteur économique, industriel ou militaire.
Enfin, on parle de métaux critiques qui est une notion géopolitique, et donc extrêmement dynamique. Certains métaux sont considérés comme critiques aujourd’hui, alors qu’ils ne l’étaient pas il y a cinq ans, et inversement. C’est quelque chose qui bouge, parce que ce qui définit la criticité d’un métal, c’est la conjonction de deux choses : l’importance pour l’économie d’une part et le risque d’approvisionnement.
Prenons un scénario peu probable, juste pour bien faire comprendre cette notion : si demain, l’Australie devient une dictature et décide tout d’un coup de dire “Nous, on ne vend plus nos métaux qu’à la Chine”, il y a tout un tas de métaux qui vont devenir des métaux critiques pour l’Union européenne, alors que ça n’était pas du tout le cas jusqu’à présent.
Il est essential de bien avoir en tête les différences entre ces éléments, sinon on apporte de la confusion comme le fait Donald Trump (volontairement ou par manque de connaissance du sujet) lorsqu’il dit qu’il y aurait des terres rares en Ukraine. Il n’y a pas de gisement exploitable de terres rares en Ukraine. Il y a pleins de métaux, il y a du lithium par exemple mais il n’y a pas de terres rares en Ukraine.
Le retour de la guerre des ressources
Il existe un peu un cercle vicieux dans le sens où on fait la guerre pour aller chercher des ressources minérales dont on a besoin pour faire la guerre. Tout cela s’entretient très bien et on pourrait dire qu’on a un triangle avec l’extractivisme qui est complètement débridé aujourd’hui.
Par exemple, le BRGM, le Bureau des recherches géologiques et minières en France, assure que dans les 30 prochaines années, nous allons extraire autant de métaux dans le monde que ce qu’on a extrait depuis le début de l’humanité. Le BRGM dit cela en s’en réjouissant. “C’est formidable, c’est une opportunité économique exceptionnelle”. Pourtant, on le sait bien, extraire autant de métaux en 30 ans que ce qu’on a fait en 2000 ans, c’est une complète catastrophe écologique, une catastrophe pour des milliers de territoires qui vont être sacrifiés.
L’extractivisme est à la fois une cause et une conséquence de la guerre et des tensions géopolitiques
Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas eu des conflits géopolitiques où la question des métaux était aussi explicite. Cela ne veut pas dire qu’avant, il n’y avait pas des enjeux d’aller chercher du pétrole par exemple dans certains pays, mais on ne le disait pas comme ça. Affirmer que l’objectif c’est les ressources, cela marque une forme de retour d’un certain matérialisme qu’on avait oublié.
Car depuis quelques décennies, la géopolitique ne s’embarrassait plus des ressources physiques, ne s’embarrassait plus des limites physiques. La France possédait un stock de métaux stratégiques qu’on a vendu intégralement, il y a 25 ans, et là, on est en train de réfléchir à peut-être le reconstituer.
Ces 25 ans, à quoi ça correspond ? À l’hégémonie du secteur tertiaire dans les économies occidentales et à la parenthèse enchantée du numérique, en fait. Pendant 25 ans, on s’est dit « c’est bon, on va tout digitaliser » donc les ressources, c’est un peu un truc du passé. Avant, on avait besoin du charbon et du fer, et puis maintenant, on a besoin des écrans et de nos cerveaux.
Aujourd’hui, le retour du matérialisme justifie dans le discours de dire « En fait, maintenant, on va vraiment faire la guerre pour des ressources », qui est quelque chose qu’on ne disait plus du tout.
La décroissance une réponse stratégique
Il me semble que dans ce contexte-là, le fait de porter un projet de décroissance des flux de matière et d’énergie c’est une réponse qui est à la fois bien sûr écologique, et ça on le savait, mais c’est aussi vraiment une réponse géopolitique.
Si on regarde la stratégie de l’Union Européenne aujourd’hui sur les métaux, par exemple, c’est de dire, on va essayer d’être moins dépendant ou plus précisément d’être moins monodépendant. Et donc dans la stratégie CRMA (Critical Raw Materials Act) de l’Union Européenne c’est de dire pour chaque métal il faut que l’Union Européenne ne soit pas dépendante à plus de 65% d’un même pays. En général, c’est la Chine qui est visée. Car quand on est dépendant à plus de 65% d’un même pays, en général, c’est de la Chine. Parfois, c’est d’autres pays. Mais il n’y a aucune réflexion au niveau de l’Union européenne sur le volume global.
Et donc, c’est bien de dire qu’on va essayer de diversifier les sources, mais si on continue à augmenter nos besoins en métaux, on va quand même rester dans une dépendance économique et géopolitique qui ne paraît pas soutenable
Porter ce projet, insister sur la décroissance des flux de matière et donc de métaux me paraît une réponse géopolitique adaptée et pas du tout quelque chose à côté de la plaque, comme on peut parfois l’entendre dire. Non, la décroissance fait partie d’une réponse géopolitique adaptée.
Fanny VERRAX