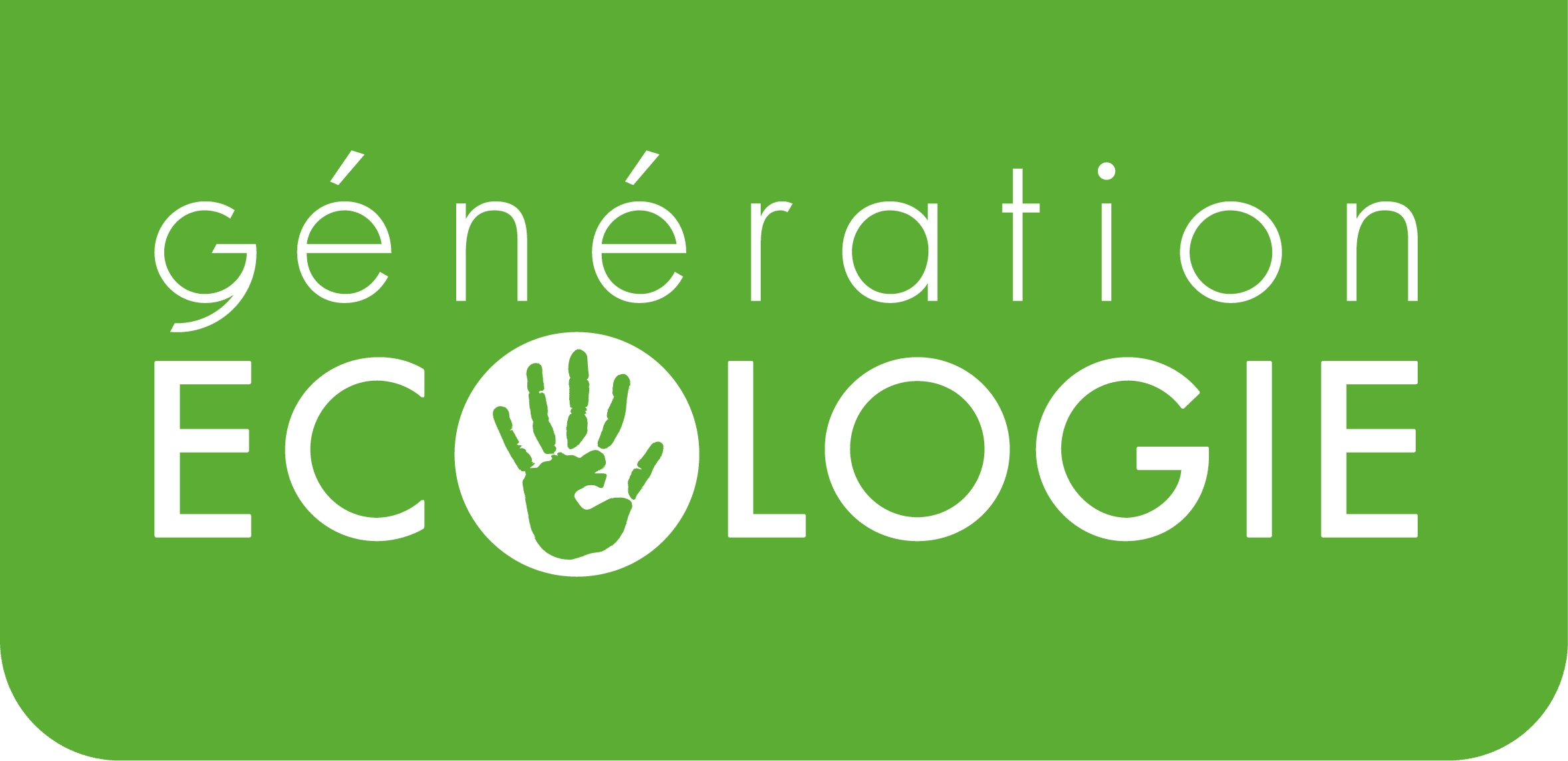14 avril 2025
Cahier d’acteur de Génération Écologie Pyrénées-Atlantiques dans le cadre de la consultation publique sur le plan d’action pour la préservation des sols forestiers. Pour plus de facilité de lecture vous pouvez lire ce texte au format PDF ici.
Pour Génération Écologie Pyrénées-Atlantiques, le plan d’action gouvernemental pour la préservation des sols forestiers s’inscrit dans une logique à court terme et extractiviste. Il passe sous silence les spécificités des forêts de montagne des Pyrénées-Atlantiques, notamment l’usage du feu pour le débroussaillage en vue du pâturage, ainsi que les projets relevant de la maladaptation, tels que ceux de production de kérosène à partir du bois des forêts pyrénéennes. Ce plan, sans ambition réelle, sans budget dédié, et fondé sur des réglementations dépassées face aux effets du changement climatique, risque d’accélérer la dégradation des forêts et de leurs sols.
Pourquoi protéger les forêts ?
Une forêt laissée en libre évolution suit un cycle naturel de 300 à 400 ans selon les essences. Protéger les sols forestiers, c’est donc préserver les forêts dans ce qu’elles ont encore à nous offrir pour les siècles à venir : remèdes, nourriture, régulation de l’humidité, filtration de l’air et de l’eau, stockage du carbone, refuge pour la biodiversité, bois pour le chauffage ou la construction…
Avec un réchauffement climatique déjà supérieur à +1,5 °C en France — seuil fixé dans l’Accord de Paris pour limiter les impacts — et une trajectoire estimée à +4 °C d’ici 2100 en l’absence de réduction significative des émissions de gaz à effet de serre, la dégradation des écosystèmes forestiers représente un risque majeur pour notre avenir. La gestion « raisonnée » des forêts n’est plus suffisante.
Il est désormais urgent de renforcer l’éducation, les réglementations et la législation, notamment en montagne, où les effets du changement climatique sont exacerbés.
Des forêts pyrénéennes fragilisées
Dans les Pyrénées, des siècles d’activité pastorale, d’exploitation métallurgique et d’agriculture ont contribué à la disparition de certaines forêts et à l’appauvrissement des sols. Aujourd’hui, comme ailleurs, ces forêts souffrent du réchauffement climatique. En France, la mortalité des arbres a augmenté de 80 % en dix ans (1). Soumises à des canicules de plus en plus fréquentes, les forêts deviennent vulnérables à des maladies multiples et imprévisibles ; certaines essences sont menacées de disparition à court terme (2).
Une humidité naturelle importante dans l’ouest des Pyrénées protège la forêt des incendies naturels. Pourtant, les incendies sont nombreux chaque année : 9 incendies sur 10 sont d’origine humaine (3), liés à des écobuages officiellement encadrés. Mais ces derniers débouchent régulièrement sur des incendies incontrôlés, dégradant sols, arbres, bâtiments et biodiversité. Le SDIS doit intervenir fréquemment, avec un impact écologique non négligeable. Par ailleurs, des éleveurs constatent que l’herbe ne repousse plus aussi bien sur les zones brûlées, signe que le climat ne permet plus de perpétuer ces pratiques de manière durable.
Dans les Pyrénées-Atlantiques, les écobuages sont pratiqués sur 16 000 à 20 000 hectares chaque année (4). Cette technique fragilise les sols, les rendant plus vulnérables à l’érosion et au ruissellement.
Les conséquences, pourtant bien identifiées dans les plans de prévention des risques (5,6), se manifestent concrètement : en septembre 2024, les villages d’Etsaut et de Cette-Eygun, en vallée d’Aspe, ont été durement touchés par des crues et pluies torrentielles , illustrant les dangers de sols dégradés face aux événements climatiques extrêmes.
Des projets destructeurs largement contestés sous couvert de « transition écologique »
La forêt, dans son rôle vital pour la lutte contre le réchauffement climatique, devrait être protégée de toute logique extractiviste. Pourtant, les projets menaçants se multiplient. Entre 2020 et 2022, la mobilisation citoyenne a permis de bloquer l’implantation d’une méga-scierie à Lannemezan par le groupe Florian. Depuis 2023, le projet E-Cho d’Elyse Énergie mobilise plus de 60 associations de protection de l’environnement. Ce projet prévoit de prélever 300 000 à 400 000 tonnes de bois par an pour produire du kérosène couvrant à peine 1,3 % des besoins du trafic aérien français.
Même si les outils juridiques et démocratiques sont faibles, la population continue de se mobiliser avec détermination face à ces menaces.
Propositions concrètes pour le plan
Axe 1 : Intégrer des études d’impact sur la biodiversité et la qualité des sols liées aux écobuages.
Axe 2 : Développer, financer et encadrer des alternatives aux écobuages, notamment via le pâturage (élevages « quatre dents ») ou des méthodes mécaniques.
Axe 3 : Ne plus subventionner des projets dits « verts » qui nuisent aux forêts, relevant de la maladaptation.
Axe 6 : Faire évoluer les politiques forestières à la hauteur des enjeux
Les failles de notre cadre législatif sont criantes, alors même que la Commission nationale du débat public est menacée. Le cas du projet E-Cho est édifiant : son bilan carbone est jugé acceptable selon les normes européennes, parce qu’il ne prend pas en compte la destruction des puits de carbone naturels que sont les arbres abattus
Nous sommes en retard. Notre droit à un environnement sain est mis à mal. La Charte de l’environnement de 2004 a beau avoir valeur constitutionnelle, les attaques contre les institutions publiques et les lois de protection de l’environnement se multiplient au nom de la rentabilité. Rachel Carson alertait déjà en 1962, dans Printemps silencieux :
« Notre époque est celle de la spécialisation ; chacun ne voit que son petit domaine, et ignore ou méprise l’ensemble plus large où pourtant il vit. Notre époque est aussi celle de l’industrie ; personne ne conteste à son prochain le droit de gagner un dollar, quelles que soient les conséquences. »
Pour un État-résilience
Ce plan gouvernemental ne répond ni à l’urgence, ni à la gravité du moment. Il ignore les pratiques destructrices, ne renforce pas la législation, et surtout, il n’est pas financé. Sans moyens, aucune transformation ne sera possible.
Il s’inscrit dans une logique extractiviste dépassée et ne prend pas en compte les alertes lancées par les scientifiques et la population, qui subit et s’inquiète des bouleversements de son environnement.
Génération Écologie Pyrénées-Atlantiques appelle de ses vœux une nouvelle étape historique de la construction républicaine, après celle de l’État-providence : l’État-résilience. La vulnérabilité de la population face aux effondrements écologiques justifie une nouvelle forme de protection collective.
L’État-résilience assure la gestion de crise, la remédiation des vulnérabilités nationales, fixe le cadre général et les moyens mis à disposition en réponse aux besoins des territoires. Notre sécurité, au sens physique du terme, est en jeu. Nous avons une obligation de résultat. Nous avons donc une obligation de moyens.
(1) Site vie-publique. fr : https://www.vie-publique.fr/eclairage/286488-forets-francaises-un-avenir-lie-au-changement-climatique
(2) Site de l’office national des forêts: https://www.onf.fr/vivre-la-foret/%2B/1feb::deperissement-des-forets-quel-etat-des-lieux-aujourdhui.html
(3) Préfet Eric Spitz : https://www.larepubliquedespyrenees.fr/faits-divers/incendie/incendies-les-pyrenees-atlantiques-renforcent-la-protection-11736874.php
(4) Plan départemental d’écobuage 2021: https://www.iphb.fr/wp-content/uploads/2023/02/PDE_ADEM.pdf
(5) Plan de Prévention des Risques d’Etsaut.
(6) Plan de Prévention des Risques Naturels de Cette Eygun.